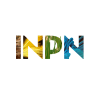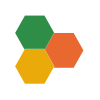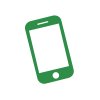Découvrez la publication de l'Observatoire national de la biodiversité sur les forêts

Découvrez la publication de l'Observatoire national de la biodiversité sur les forêts
L'ONB lance une série de publications thématiques mettant en lumière ses suivis de la biodiversité en France hexagonale et en Outre-mer
Découvrir la publicationL'Observatoire national de la biodiversité lance la refonte de sa cartographie des pressions

L'Observatoire national de la biodiversité lance la refonte de sa cartographie des pressions
Une première planche cartographique vient d'être publiée et porte sur les espèces exotiques envahissantes, l'une des principales pressions anthropiques qui pèsent sur la biodiversité.
Découvrir le projetUn référentiel des pressions exercées sur la biodiversité pour faciliter la réutilisation des données

Un référentiel des pressions exercées sur la biodiversité pour faciliter la réutilisation des données
De multiples pressions d'origine anthropique s'exercent sur la biodiversité et la fragilisent. Pour apporter des réponses adaptées et cohérentes, il est nécessaire de caractériser ces pressions et de disposer d'un langage commun.
En savoir plusL’Observatoire national de la biodiversité publie sa plaquette de présentation

L’Observatoire national de la biodiversité publie sa plaquette de présentation
Pour découvrir ou mieux comprendre l’Observatoire national de la biodiversité (ONB) une plaquette synthétique répond à toutes vos questions sur son rôle, ses productions, son périmètre ou encore son fonctionnement.
Lire l'actualitéÉnergies renouvelables : un outil pour éclairer les communes sur les zonages environnementaux

Énergies renouvelables : un outil pour éclairer les communes sur les zonages environnementaux
Une interface cartographique est mise à disposition des gestionnaires de communes pour les aider à identifier des aires propices à l’implantation d’énergies renouvelables terrestres.
Découvrir l'outil cartographique